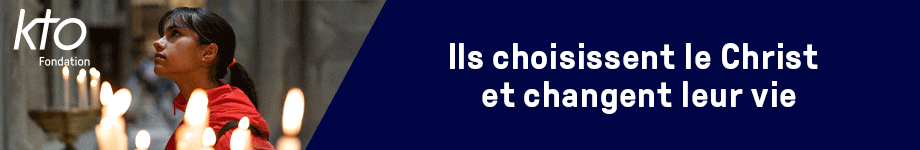« Alors que je m’apprête à effectuer mon voyage apostolique en Turquie, je souhaite, par cette Lettre, encourager dans toute l’Église un élan renouvelé dans la profession de foi dont la vérité, qui constitue depuis des siècles le patrimoine commun des chrétiens, mérite d’être confessée et approfondie d’une manière toujours nouvelle et actuelle », indique le pape au début de ce texte d’une grande densité historique et théologique, divisé en 12 parties.
« Dans l’unité de la foi, proclamée depuis les origines de l’Église, les chrétiens sont appelés à marcher ensemble, en gardant et en transmettant avec amour et joie le don reçu », explique Léon XIV, en montrant que le Concile de Nicée, « premier événement œcuménique de l’histoire du christianisme, il y a 1700 ans ». a exprimé l’essentiel de la foi chrétienne, qui se résume dans cette formule : « Nous croyons en Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, descendu du ciel pour notre salut ».
« Aujourd’hui encore, dans la célébration eucharistique dominicale, nous prononçons le Symbole de Nicée-Constantinople, profession de foi qui unit tous les chrétiens », rappelle le pape dans ce texte. Il assure que cette profession de foi dans le Christ mort et ressuscité « nous donne l’espérance dans les temps difficiles que nous vivons, au milieu des craintes nombreuses et des préoccupations, des menaces de guerre et de violence, des catastrophes naturelles, des graves injustices et des déséquilibres, de la faim et de la misère dont souffrent des millions de nos frères et sœurs ».
Une histoire mouvementée et violente
Dans un long développement historique, il rappelle que « les temps du Concile de Nicée n’étaient pas moins troublés » et qu’en 325, « les blessures des persécutions contre les chrétiens étaient encore vives ». « L’Édit de tolérance de Milan (313), promulgué par les deux empereurs Constantin et Licinius, annonçait l’aube d’une nouvelle ère de paix » mais, malgré cela, « disputes et conflits ont rapidement émergé au sein de l’Église après les menaces extérieures ».
Le pape revient sur l’hérésie arianiste qui a conduit alors une partie du clergé à croire que « Jésus n’est pas vraiment le Fils de Dieu », mais un « être intermédiaire » entre Dieu et l’humanité. Cependant, des prises de position d’évêques ont permis de recadrer la doctrine chrétienne en insistant sur l’identité divine du Christ. « Dieu n’abandonne pas son Église, il suscite toujours des hommes et des femmes courageux, des témoins de la foi et des pasteurs qui guident son peuple et lui indiquent le chemin de l’Évangile », assure Léon XIV dans ce texte.
C’est toutefois dans un contexte tendu que la réunion « des 318 Pères », se déroula sous la présidence de l’empereur. « Le nombre d’évêques réunis était sans précédent. Certains d’entre eux portaient encore les traces des tortures subies pendant la persécution. La grande majorité d’entre eux venait d’Orient, alors qu’il semble que cinq seulement aient été occidentaux », précise l’actuel évêque de Rome, qui précise que deux prêtres romains y furent délégués par son lointain prédécesseur, le pape Sylvestre Ier, qui régna de 314 à 335.
Cette réunion a permis de structurer progressivement les bases de la foi chrétienne, en s’appuyant sur le monothéisme biblique plus que sur les catégories intellectuelles de la philosophie grecque. « Les Pères de Nicée ont voulu rester fermement fidèles au monothéisme biblique et au réalisme de l’incarnation. Ils ont voulu réaffirmer que l’unique vrai Dieu n’est pas loin de nous, inaccessible, mais au contraire qu’il s’est fait proche de nous et est venu à notre rencontre en Jésus-Christ », explique Léon XIV.
« Le Credo nicéen ne nous parle donc pas d’un Dieu lointain inaccessible, immobile, qui repose en lui-même, mais d’un Dieu proche de nous, qui nous accompagne dans notre marche sur les chemins du monde et dans les lieux les plus obscurs de la terre », explique le pape, en montrant que les affirmations du Credo révolutionnent « les conceptions païennes et philosophiques de Dieu ». A l’inverse des conceptions de la mythologie antique, l’immensité du Dieu chrétien « se manifeste dans le fait qu’Il se fait petit, qu’Il se dépouille de sa majesté infinie pour devenir notre prochain dans les petits et les pauvres », insiste-t-il.
Un Credo mieux assimilé par le peuple que par le clergé
La réception du Credo de Nicée ne se fit toutefois pas au même rythme partout, tant l’hérésie arianiste demeura présente dans les élites impériales et dans une partie du clergé. Paradoxalement, le Credo fut plus facilement assimilé par la population que par les clercs. « Les oreilles du peuple sont plus saintes que le cœur des prêtres », écrira saint Hilaire de Poitiers (vers 315-367) à ce sujet.
Outre saint Hilaire, le pape rend hommage dans ce texte aux grands figures qui ont joué un rôle central dans la diffusion du Credo de Nicée, parmi lesquelles en Orient, saint Athanase d’Alexandrie, et en Occident, saint Martin de Tours (vers 316-397), saint Ambroise de Milan (333-397) et, bien sûr, saint Augustin d’Hippone (354-430), son maître spirituel.
Depuis qu’il a finalement été reconnu comme « universellement contraignant » lors du Concile de Chalcédoine en 451, le Credo de Nicée-Constantinople est « la profession commune de toutes les traditions chrétiennes », unissant donc, encore aujourd’hui, catholiques, orthodoxes et protestants autour de la même foi.
Suivre Dieu et non les idoles
Sur un ton proche du style du pape François, Léon XIV invite dans une dernière partie, chaque lecteur à un « examen de conscience » sur son rapport au Credo, car « ce que nous disons par la bouche doit venir du cœur, pour être témoigné dans la vie ». « Comprenons-nous et vivons-nous ce que nous disons chaque dimanche, et que signifie ce que nous disons pour notre vie ? », demande-t-il.
« Aujourd’hui, pour beaucoup, Dieu et la question de Dieu n’ont presque plus de sens dans la vie. Le Concile Vatican II a souligné que les chrétiens sont au moins en partie responsables de cette situation, car ils ne témoignent pas de la vraie foi et cachent le vrai visage de Dieu par des modes de vie et des actions éloignés de l’Évangile », reconnaît le pape.
« Des guerres ont été menées, des personnes ont été tuées, persécutées et discriminées au nom de Dieu. Au lieu d’annoncer un Dieu miséricordieux, on a parlé d’un Dieu vengeur qui inspire la terreur et punit », s’attriste Léon XIV, invitant donc les chrétiens à témoigner de leur espérance avec plus de cohérence.
« L’unique et seul Dieu est-Il vraiment le Seigneur de la vie, ou bien y a-t-il des idoles plus importantes que Dieu et que ses commandements ? », demande Léon XIV, en questionnant le lien entre l’enracinement spirituel des chrétiens et leur attitude sociale et écologique.
« Suis-je disposé à partager les biens de la terre, qui appartiennent à tous, de manière juste et équitable ? Comment est-ce que je traite la création, qui est l’œuvre de ses mains ? Est-ce que j’en fais usage avec révérence et gratitude, ou est-ce que je l’exploite, la détruis, au lieu de la préserver et de la cultiver comme la maison commune de l’humanité ? », interpelle-t-il notamment.
Le commandement chrétien de l’amour réciproque
« Si Dieu nous aime de tout son être, alors nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Nous ne pouvons pas aimer Dieu que nous ne voyons pas, sans aimer aussi le frère et la sœur que nous voyons », insiste Léon XIV, utilisant un langage incluant les deux sexes, un fait notable dans l’histoire du magistère des papes. « À la suite de Jésus, l’ascension vers Dieu passe par la descente et le dévouement envers les frères et sœurs, surtout les derniers, les plus pauvres, les abandonnés et les marginalisés », insiste le pape.
« Face aux catastrophes, aux guerres et à la misère, nous ne pouvons témoigner de la miséricorde de Dieu aux personnes qui doutent de Lui que lorsqu’elles font l’expérience de sa miséricorde à travers nous », insiste le pape.
« Dans un monde divisé et déchiré par nombre de conflits, l’unique communauté chrétienne universelle peut être un signe de paix et un instrument de réconciliation », insiste le pape, appelant à renforcer le mouvement œcuménique autour de la mémoire commune des martyrs, 30 ans après la publication de l’encyclique de Jean-Paul II Ut unum sint.
« Le Saint-Esprit est le lien d’unité que nous adorons avec le Père et le Fils », explique le pape. « Nous devons donc laisser derrière nous les controverses théologiques qui ont perdu leur raison d’être pour acquérir une pensée commune et, plus encore, une prière commune au Saint Esprit, afin qu’il nous rassemble tous dans une seule foi et un seul amour », explique Léon XIV.
Le chef de l’Église catholique voit dans cette quête de la réconciliation des chrétiens « un défi théologique » et « un défi spirituel, qui exige le repentir et la conversion de tous ». Il conclut cette Lettre par une prière invoquant l’Esprit Saint « pour unir les cœurs et les esprits des croyants » et leur permettre « de goûter à la beauté de la communion ».
Source : I.Media